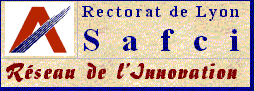|
IV
- Analyse des enquêtes écrites et des entretiens oraux auprès de tous
les personnels de l’établissement
Où tout semble n’être qu’affaire de
paradoxes ! …
 1) La violence diminue ou elle se banalise ? 1) La violence diminue ou elle se banalise ?
« On n’est pas traumatisé »,
« On se sent en sécurité », « J’ai moins de
réparations à effectuer », « Il y a moins de
dégradations », «Les élèves sont assez corrects avec
nous ».
Il existe un relatif consensus pour reconnaître qu’on
n’est pas encore débordé par des phénomènes de violence
incontrôlables, mais « l’équilibre est précaire, tout peut
basculer ». Il n’y a pas trop de violence physique, mais beaucoup
de violence verbale, surtout entre les élèves. Cela semble être un
« jeu » dans lequel ils se laissent entraîner.
La question se pose de savoir si l’adulte en
général dans cet établissement ne s’habitue pas à un climat que l’on
pourrait par ailleurs qualifier de violent. Jeux ? Actes
violents ? Ou bagarres ? Débordements de langage sur lesquels
on ferme les oreilles ? Ou injures insultantes et dégradantes ?
Tout est affaire d’appréciation…N’aurait-on pas tendance « à
laisser passer des choses pour permettre de ne pas arriver à la violence
physique », comme pour aménager « un sas de
sécurité » ? .Surtout si l’on travaille ici depuis de
nombreuses années, n’y a-t-il pas élévation de notre seuil de
tolérance, et cela même pour poursuivre un objectif pédagogique d’apprentissage ?
La circulation dans le hall, les escaliers et les
couloirs, paraît difficile, désordonnée et très bruyante.
« Parfois, ils nous bousculent car ils ne nous voient pas ; c’est
comme si on était invisible » se plaignent certains membres du
personnel administratif. « Trop tenus ou trop nombreux dans les
classes, ils se défoulent à la sortie ». Et trop souvent, de trop
nombreux élèves « se promènent » au lieu de travailler,
pour des motifs plus ou moins futiles. Ils « traînent »
après un passage à l’infirmerie, un retard, pour rejoindre leur salle.
En tout cas, il apparaît qu’il y a des périodes,
des moments, des séries, des vagues d’épisodes violents. Pour
certains, c’est lié aux moments où l’on parle d’orientation ;
d’autres parlent d’atmosphère pesante, d’agressivité envers le
système, les profs, et même de menaces verbales pour certains aide
-éducateurs qui se. sentent davantage en insécurité, parce qu’ils
sont moins en position d’autorité.
Enfin il faut bien garder en tête qu’il est
difficile de parler et d’évoquer la ou les violences subies ou
provoquées. Le secret peut toujours exister, caché sous une
« chape de silence ». La peur est mauvaise conseillère, elle
subsiste : « Si on les engueule, ils vont se venger ».
 2) Il s’agit d’être, plutôt que de faire : 2) Il s’agit d’être, plutôt que de faire :
« Je crois que nos élèves se sentent soutenus
et aimés dans ce Collège. Ils nous le rendent plutôt bien… »
Sans nier les importantes difficultés et les
problèmes quotidiens, ceux qui se sont exprimés décrivent leur attitude
générale comme empreinte de politesse et de respect envers tous les
élèves et tous les membres de la communauté éducative.
Nous essayons de garder notre calme, en toute
occasion, aidés pour cela par un certain détachement, un certain recul,
liée peut-être à l’expérience. Ce calme peut réduire l’effet
miroir, où la violence de l’élève ne lui est pas forcément renvoyée
dans les mêmes termes par l’adulte. Réagir par la fermeté tranquille,
mais aussi par « l’humour, l’extrême amabilité, la politesse
et la déférence semble faire tampon à la violence de l’élève et l’amortir,
en le décontenançant ».
Nous cherchons à préserver notre envie de
travailler avec les élèves, et nous pensons qu’il est très
bénéfique qu’ils perçoivent le plaisir que nous avons d’être avec
eux.
C’est donc un combat de chaque jour pour positiver
ce que nous vivons ensemble, et ne pas se laisser envahir par un sentiment
d’échec. Les choses se construisent peu à peu, dans la durée et la
constance, et nous ne voulons pas rester dans le registre de l’impulsif,
être trop impliqué dans l’action.
L’adulte veut se poser en tant que
référent : il donne des repères, en étant garant des droits et
des devoirs de l’élève. Il intervient par exemple dans les couloirs,
car il est co-responsable de toute la vie de l’établissement. L’enseignement
de la règle qui fixe cadre et limites est en soi prévention de la
violence. Les sanctions sont annoncées, explicitées comme suite logique
d’une démarche, puis appliquées quand c’est nécessaire.
Nous souhaitons être justes : mais le jeune
comprend fort bien qu’être juste n’est pas forcément appliquer
exactement de la même façon, la même sanction pour le même
débordement. Etre juste de façon éducative veut dire adapter sa
réponse à l’être humain en formation qui est en face de nous, dans sa
complexité.
Nous avons énuméré ici tout ce que doit être et
doit faire l’adulte devant l’enfant… mais hélas tout n’est pas
aussi idyllique ! Pourquoi ? Vaste problème… mise en cause de
l’approche de l’enseignant, de sa personnalité, de ses problèmes
etc.…
 3) L’élève dans sa globalité : 3) L’élève dans sa globalité :
Effectivement, nous éprouvons de l’estime pour
chaque élève, en tant qu’être humain en développement, et non
réduit à ses résultats scolaires.
Nous cherchons à prendre en compte l’élève dans
sa totalité, dans sa globalité. « Nous le regardons, le saluons,
lui sourions ; ce n’est pas un meuble ! »
L’équipe Santé-Social, infirmière et assistante
sociale, prend la responsabilité du suivi des élèves psychologiquement
et socialement fragiles, ainsi que de l’éducation à la santé.
L’heure de Vie de Classe est avant tout un moment
institué où les conflits, difficultés, informations et autres peuvent
se dire et se parler. C’est un lieu de connaissance réciproque du
groupe classe et du Professeur Principal, qui déborde les seules
compétences scolaires.
Le plus possible, chaque élève doit trouver un lieu
ou un temps où il est considéré avec un regard différent, et où il
peut faire entendre sa voix : formation de délégués, clubs
variés, animations du temps de midi.
Ce temps de midi justement…Le personnel de cuisine
dit « ne pas être trop confronté à la violence, du fait même que
le temps de restauration à la cantine est vécu comme un moment de
détente. Face aux bousculades, aux gaspillages, au niveau sonore élevé,
aux « petits vols » de nourriture, à certains élèves plus
pénibles, ce personnel dit « chercher à répondre sans trop de
méchanceté », en évoquant le problème des élèves qui ne
prennent pas de repas bien réguliers dans leurs familles.
En cas de difficultés de comportement, nous voulons
« aider l’enfant à prendre conscience que son fonctionnement n’est
pas compatible avec la vie du groupe ». Bien souvent d’ailleurs,
les élèves n’ont pas conscience de la violence de leur langage. Les
fiches de suivi, plutôt que sanctions, sont données par toute l’équipe
pour guider l’élève vers un progrès dans son comportement et son
travail. Chaque heure, pendant une ou deux semaines, y sont annotées les
appréciations négatives, mais aussi positives.
Un point est vécu de façon particulièrement
positive : ce sont les entretiens individualisés d’orientation
concertée. Deux fois par an, chaque élève de 3ème est reçu
avec sa famille, le professeur principal de la classe, le Chef d’Établissement
et la Conseillère d’Orientation, pendant une demi-heure. Nous espérons
que ce dispositif permet à l’élève de se placer dans une dynamique de
choix d’orientation personnel et positif, et de ce fait éviter la
violence d’une orientation subie par l’échec.
Il s’agit :
- d’une part, de prendre en compte l’individu
dans sa globalité, c’est à dire s’investir affectivement par
exemple ;
- et d’autre part, aussi de se protéger, donc de
prendre de la distance…
C’est paradoxal ! Et un certain nombre de
collègues reconnaissent avoir du mal à prendre du recul par rapport à
leur pratique, à analyser.
 4) Mise en confiance : 4) Mise en confiance :
Sur le plan éducatif tout d’abord, nous mettons un
point d’honneur à accorder du temps individuel à chacun
personnellement : rencontres individuelles avec le professeur
principal ou n’importe quel professeur ; aide scolaire
individualisée fournie par les professeurs ou les aide-éducateurs,
rendez-vous réguliers et répétés avec les familles, tutorat pour les
élèves de 6ème les plus fragiles. Ce tutorat est un
élément très important à notre dispositif, et il faut noter que les
professeurs qui en ont la responsabilité travaillent à ce propos dans un
groupe d’analyse de la pratique.
Sur le plan pédagogique, nous reconnaissons le droit
à l’erreur, comme étant un point essentiel de l’apprentissage sur
lequel rebondir. Nous voulons bannir de notre vocabulaire les mots trop
négatifs : « nuls ! … » ; mais plutôt
valoriser l’effort de l’élève, l’encourager.
« Nous voulons offrir l’occasion à chacun de
se révéler performant, au moins une fois ».
Pour cela :
- Nous varions nos critères d’évaluation :
alternance de devoirs difficiles et plus faciles, contrôles réguliers
pour qu’avec la multiplicité de notes, il soit plus facile de se
« remonter », prise en compte de la pertinence de la
participation orale ;
- Nous proposons des situations variées : mise
en projet de l’élève dans les Parcours Pédagogiques Diversifiés,
groupes restreints de remédiation, d’études dirigées, travaux
transversaux en interdisciplinarité (exemple en 3ème,
français-histoire géo, 1ère Guerre Mondiale à travers des
lettres de Poilus), alternance de la Troisième d’Insertion.
« Il faut tenir sa classe, être strict, et en
même temps encourager les élèves. C’est épuisant et usant ».
On ne peut nier les difficultés liées aux faiblesses inhérentes à
chacun d’entre nous ; et aussi au manque de confiance de certains
parents d’élèves dans le système…
 5) Mise en situation d’écoute et de travail : 5) Mise en situation d’écoute et de travail :
« Laissons le temps au temps »
Pour accueillir correctement les élèves, nous
devons respecter leur temps de mise en route, tout en rappelant, fermement
mais sans brusquerie, nos exigences et les règles de fonctionnement. Il s’agit
d’une mise en scène où nous jouons le rôle de catalyseur pour
favoriser une entrée calme dans le travail.
« Laissons le temps au temps… » Encore
un paradoxe ou pour le moins une injonction contradictoire ! D’une
part, il faut « perdre » du temps en classe pour que les
apprentissages s’assimilent correctement par tous, et d’abord pour
tenter de résorber les lacunes ; d’autre part, nous sommes soumis
à la contrainte institutionnelle : les programmes à finir. Pour
cela, il n’y a pas de temps à perdre ! Il faut qu’ils atteignent
un niveau Brevet, voire d’entrée en 2nde générale. Comment
concilier les deux objectifs en ne mettant pas les plus faibles en échec,
l’échec étant vecteur de violence ?
Le refus de travailler de certains élèves, à un
moment ou un autre, renvoie le professeur à son propre échec pour animer
une pédagogie où chaque élève puisse réussir. C’est une violence
infligée au professeur, autant que l’insolence.
 6) L’élève acteur : 6) L’élève acteur :
Une fois mis en route, le groupe classe ne pourra
travailler sainement que si l’élève est réellement mobilisé par ce
qui se passe en classe.
Ainsi, nous laissons la parole aux élèves, et ils
le savent, pour qu’ils puissent poser leurs questions, auxquelles nous
apportons des réponses. Cette liberté de parole s’oppose à l’autoritarisme,
et favorise au contraire le dialogue. Nous cherchons, dans la mesure du
possible, à prendre en compte leurs idées.
C’est aussi respecter l’élève que de lui donner
le pouvoir de savoir où va la séance, en explicitant ses objectifs, son
menu, son plan, son contenu.
Les deux notions clés sont : personnalisation
de l’apprentissage, et valorisation de l’élève.
L’importance que nous voulons accorder à la parole
de l’élève se manifeste bien sûr par la participation orale, mais il
nous semble que cela va bien plus loin. L’Education Civique se vit comme
une discipline essentielle. Des expos (racisme, etc.…) vont permettre au
professeur de confronter les élèves à leurs propres contradictions. En
éducation civique, mais aussi dans les « défis lecture » ou
les ateliers d’écriture par exemple, cette « parole »
(orale ou écrite) déborde largement le cadre d’une participation. Il s’agit
là d’une véritable liberté d’expression et proposition d’idées
qui est reconnue à l’élève. En ce sens, il devient acteur de son
apprentissage puisqu’il prend part à la réflexion et parfois aux choix
de la séance (par exemple en atelier d’écriture).
Le CDI, haut lieu de notre Collège,
particulièrement investi et bien géré, est un lieu d’expression et de
valorisation des élèves : « défi lecture »,
intervention de conteurs, d’écrivains, de poètes, etc.…puisque
atténuer la violence verbale devrait avoir des conséquences positives
sur le reste, il s’agit ici aussi de chercher à améliorer l’expression
des élèves, leur langage, en essayant de les faire lire, ne serait ce
que des BD.
Les Parcours Pédagogiques Diversifiés offrent une
multiplicité de situations d’apprentissage plus personnalisées.
Tout cela est nettement favorisé quand nous
bénéficions de groupes restreints : il est alors plus facile de
mettre les élèves en situation de projet, en possibilité de réussite.
 7) Le tiers… : 7) Le tiers… :
Symboliquement, cette position de tiers est
particulièrement importante.
Ce peut être lors d’une exclusion de cours par
exemple : les termes du conflit entre deux personnes, 1 élève-1
professeur la plupart du temps, sont repris par une troisième personne
extérieure, la Principale Adjointe et/ou le CPE. Une fois les tensions
apaisées, après recul, un rapport écrit est demandé au professeur. La
Principale Adjointe ou le CPE prend du temps individuellement avec l’élève
pour reparler du dérapage constaté, et fait appliquer la sanction.
Lors d’un travail supplémentaire donné en
retenue, le professeur principal en est systématiquement informé ;
un aide-éducateur est plus particulièrement responsable du déroulement
et de la bonne tenue de ces heures de retenue.
Le professeur principal, personnage central de l’équipe
pédagogique, peut désamorcer, de sa position différente, les situations
critiques.
Le tiers, qui peut être hiérarchiquement supérieur
(Principale ou Principale Adjointe), recadre, prend du temps
individuellement avec l’élève et ses parents, reprend la parole du
professeur, assoit son autorité, fait appliquer la sanction.
Ce n’est pas la toute puissance de tel ou tel
professeur dans sa liberté pédagogique, mais la référence à une
règle collective.
 8) Les locaux : 8) Les locaux :
Les locaux, et l’architecture, sont conviviaux,
agréables à vivre et bien entretenus grâce aux services efficaces de l’ouvrier
d’entretien et du personnel de ménage. « J’investis ma salle de
classe comme un lieu que je souhaite garder propre et agréable, pour un
temps que j’investis. »
On est content de la « beauté » des
lieux, on souhaite les garder propres, mais la réalité vient souvent
nous heurter. C’est un paradoxe de plus : l’esthétique très
souriante de l’architecture, ne se vit pas au jour le jour comme très
fonctionnelle. Des « niches » rendent la surveillance plus
difficile dans certaines zones, et peuvent donc faciliter les
dégradations. La salle polyvalente, grande, claire et spacieuse, est un
autre exemple de ce paradoxe. Elle est riche de ses différentes
fonctionnalités possibles, du réfectoire à la salle de permanences,
mais sa surveillance est difficile, et nécessite des moyens humains
importants, pas toujours disponibles.
Le soir, devant certaines salles de classe toutes
chamboulées, les dames de service reconnaissent « nettoyer les
violences faites aux professeurs ». Cela dépend des classes et des
périodes toujours. « Avant les vacances, c’est la
catastrophe ! » Les élèves « se vengent en salissant,
semblent faire ce qu’ils veulent, le mobilier est en désordre, les
cartouches d’encre sont giclées, on retrouve des gobelets de chocolat
ou des boîtes de boisson de partout ! »
Les
toilettes sont un lieu particulièrement sensible, on s’y cache, et l’on
peut y retrouver des cigarettes. Les élèves semblent s’y retrouver
plus souvent que nécessaire et autorisé, pendant les permanences, les
inter-cours, les récréations.
 9) L’équipe : 9) L’équipe :
Tout cela, nous essayons, nous disons bien nous
essayons de le faire, mais cela n’est possible que sous la condition
expresse de faire circuler la parole et les informations dans l’équipe
éducative adulte.
« Fort de notre passé, nous regardons l’avenir. »
Il semblerait qu’il existe une tradition dans ce
Collège, une « Culture du Collège », qui comme toute
tradition ou culture n’a de sens que si elle se transmet de façon
vivante. Pour cela il est peut-être préférable d’éviter une trop
grande instabilité dans l’équipe.
« Ici, en salle des profs, on se parle et on s’écoute »,
disent les nouveaux collègues, et même plus globalement, « dans ce
Collège, on se parle et on s’écoute » affirme l’ensemble du
personnel.
Certaines personnes « particulièrement
motivées », forment un « noyau dur », où le travail
devient presque « militant »pour « porter une aide et
une attention particulière aux enfants en difficulté scolaire et
sociale ». Les nouveaux collègues repèrent certaines personnes
comme « référents », et effectivement l’accueil et l’accompagnement
des nouveaux est un défi que nous devons toujours relever.
Nous favorisons le travail en équipe, à tous les
niveaux. Tous prennent à cœur leur travail, quelle que soit la fonction
occupée. Nous devons tous nous sentir concernés par ce que font d’autres
collègues ; nous nous « soutenons » entre adultes.
« Chaque adulte a toujours le droit et le devoir de reprendre chaque
élève, fermement mais sans violence, quand il y a problème de
comportement, par exemple dans les couloirs ».
Collectivement, nous nous employons à définir et à
fixer les mêmes règles pour tous, à être clairs et posés dans nos
exigences, à nous y tenir. Par discipline, nous forgeons une progression
commune et nous proposons certains devoirs en commun.
Le respect réciproque enfant – adulte est un point
absolument fondamental qui peut être malheureusement remis en cause dans
des circonstances difficiles. Ainsi en est il du délicat problème du
regard différent porté par l’élève sur l’adulte, suivant son
statut. « La parole de l’aide-éducateur n’est pas ressentie
comme celle du surveillant ».
Et que dire de l’accompagnement des remplaçants ou
vacataires ? Ces derniers sont parfois - pas toujours
heureusement ! - démunis face à notre public particulier, et il n’est
pas aisé de leur porter une aide. Une situation par trop bloquée et
conflictuelle met en péril le fragile équilibre que nous avons pu
essayer de construire sur une classe, tant au niveau comportement que du
point de vue des acquisitions scolaires. Nous interpellons ici l’Institution
pour qu’elle mesure toute sa responsabilité quant à la nomination de
« vrais remplaçants ».
Enfin encore un paradoxe : « Il ne faut
rien laisser passer, intervenir à chaque fois, rappeler la règle, mais
nous manquons de temps pour nous en occuper ».
 10) Travailler avec les familles : 10) Travailler avec les familles :
« Ce sont les familles qu’il faudrait
éduquer, parfois », avons-nous pu entendre dire par certains agents
d’entretien.
Tout au long de cette description, nous avons
insisté sur le travail que nous entreprenons en direction des familles. C’est
un axe essentiel que nous avons développé pour prévenir la violence. En
effet, certains parents donnent l’impression « d’avoir baissé
les bras » ; ils sont plus probablement démunis et dépassés.
Nous voulons, à notre niveau, les aider à remplir leur rôle, et aussi
à franchir le fossé qui peut les séparer du monde scolaire.
Plus il y a convergence entre la famille, l’élève
et l’établissement, mieux c’est. Il y a de quoi faire pour approcher
cet objectif. Il est difficile d’agir quand la famille est trop absente,
mais aussi quand elle « soutient trop le jeune » contre l’appréciation
que peuvent en avoir les adultes qui le côtoient et essaient de le faire
travailler au Collège.
En fin de trimestre, nous rencontrons les familles
pour leur rendre en main propre les bulletins scolaires de leurs enfants,
sans les envoyer donc. Il semble que ce soit vécu de façon très positive.
Quoiqu’il en soit, les problèmes existent en
dehors du Collège. « Déjà, beaucoup de choses sont faites ;
visiblement, le Collège ne peut pas répondre à tout ».
|